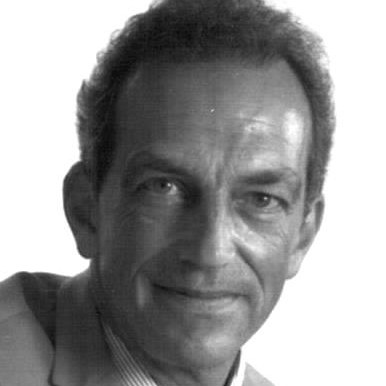Mot du Président de la Sfdi
Le prochain colloque de la SFDI se tiendra à Toulouse les 6 et 7 mai 2021 sous la direction conjointe de Lucien Rapp et de Clémentine Bories. La SFDI peut se réjouir de cette perspective, même si la crise sanitaire a retardé d’une année cette rencontre initialement programmée au printemps 2020. Il faut à cet égard saluer l’opiniâtreté des organisateurs pour maintenir ce colloque face aux aléas de cette crise. Nous espérons donc tous pouvoir nous réunir dans cette belle ville de Toulouse au printemps prochain.
Il était grand temps que la SFDI revienne à Toulouse puisque le précédent colloque de la Société dans ville a eu lieu en 1974. Le thème était alors L’élaboration du droit international public, et je me souviens que sa publication m’avait été très utile comme étudiant et doctorant. Je ne doute pas qu’il en sera de même du colloque de 2021 dont le thème est cette fois-ci L’espace extra-atmospherique et le droit international. Les deux thèmes à près de 50 ans d’intervalle semblent aux antipodes, et pourtant l’espace extra-atmosphérique contient bien d’importantes questions sur la manière d’élaborer le droit international. Entre autres peut-on dire, car le thème est si riche qu’il touche tous les aspects du droit international comme le démontre la présentation de Lucien Rapp dans son mot de présentation : privatisation, commercialisation, appropriation nationale rampante, système de défense, etc, le tout souvent sous couvert d’incertitudes juridiques ou d’utilisation volontaire de la soft law.
Cette exploration (sans jeu de mots) de l’espace sera donc passionnante car, au-delà de quelques idées reçues ou de quelques connaissances approximatives (y compris pour des juristes internationalistes), nous n’avons bien souvent qu’une connaissance lunaire (au sens figuré !) des questions posées par l’espace extra-atmosphérique dont le régime est trop rapidement jugé comparable à celui du droit de la mer. Une journée d’études à Brest en 2002 sous la direction d’Armel Kerrest sur Le droit de l’espace et la privatisation des activités spatiales avait déjà pu nous éclairer, et les riches thèmes abordés à Toulouse – trop peu prisés par la doctrine francophone - nous permettrons de continuer et d’approfondir cette exploration de l’espace.
À l’heure où les appétits des Etats, et particulièrement aux États-Unis à travers les récents accords Artemis proposés par la NASA, s’aiguisent, et où la mise en place de commandements militaires se multiplie pour un espace que l’on pensait à l’abri de tels appétits, il est donc plus que temps d’envisager le rôle du droit international aussi bien à travers les sources que les sujets et acteurs de ce droit, autrement dit revisiter le droit international à l’aune de la problématique de l’espace extra-atmosphérique car, si le droit n’est pas une arme, il reste le reflet des évolutions techniques et sociétales. Ce reflet a sans doute pâli depuis les grands textes qui s’aventuraient à encadrer le droit de l’espace extra-atmosphérique dans les années soixante et soixante-dix, en pleine guerre froide. Or il n’est jamais sain que le droit n’enlace pas l’évolution de la technique car ce décalage laisse toujours la place à des solutions empiriques qui font la part belle à certains appétits étatiques et/ou commerciaux.
C’est dire l’importance du colloque envisagé, et l’attention que nous porterons tous à ces passionnants travaux.